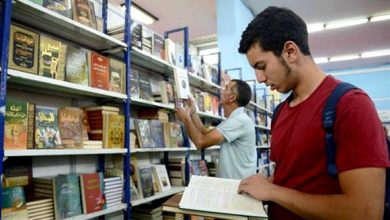Arabes et Latinos, l’histoire d’une intégration hors norms

Comme les Européens avant eux, beaucoup d’habitants du monde arabe se sont embarqués pour le Nouveau Monde afin de fuir la guerre, la misère ou les persécutions religieuses. Mais, au lieu de poser le pied aux États-Unis, la plupart se sont retrouvés en Amérique du Sud. Où ils ont prospéré.Écartelés entre le jeu de l’Empire ottoman et celui des puissances coloniales européennes, persécutés, victimes de précarité économique, des milliers d’Arabes du Proche-Orient – majoritairement chrétiens – ont, à partir de la fin du XIXe siècle, opté pour l’exil vers un continent inconnu : l’Amérique latine.« Amrik ». Au cours des quatre dernières décennies du XIXe siècle, avec le déclin de l’Empire ottoman et la pénétration du colonialisme européen dans la région, on assiste à la première grande vague de migration des Arabes du Proche-Orient vers le Nouveau Monde. Comme les Européens, la plupart d’entre eux visent l’Amérique du Nord, ces jeunes États-Unis où, dit-on alors, tout est possible, tout reste à conquérir. Et pourtant, nombre de ces immigrants originaires du Levant (Syrie, Liban, Palestine) vont découvrir à leur descente de bateau les terres chaudes, et parfois tropicales, de l’Amérique latine. Dans bien des cas, ce sont les compagnies maritimes qui les ont dupés. Et pourtant, ils vont y rester.Pour comprendre ce qui a motivé ces populations à émigrer, il faut revenir au contexte de l’époque. Entre 1840 et 1960, le Liban, intégré à l’Empire ottoman, et plus particulièrement la région du Mont-Liban, évoluent dans un contexte explosif. À l’origine, le Liban a été conquis par les Arabes au VIIe siècle. Et le Mont-Liban est devenu le refuge des minorités menacées : les Maronites (chrétiens de Syrie) s’y sont établis dès le VIIe siècle, tandis que les Druzes (adeptes d’une religion issue de l’islam) s’y installent à partir du XIe siècle. Le pays a ensuite été conquis par les Ottomans au XVIe siècle, ceux-ci laissant une certaine autonomie aux habitants du Mont-Liban. Mais, à partir de 1840, cet ilôt de coexistence pacifique va être victime du jeu des empires coloniaux et de ses propres désirs d’indépendance.Pour résumer, la région assiste à l’apparition d’un axe franco-égyptien, plutôt favorable aux chrétiens maronites, et d’un axe anglo-ottoman, plus conciliant avec les Druzes. La Sublime Porte, les Européens et les Égyptiens créent donc une rivalité entre Chrétiens et Musulmans. Et les simples différences confessionnelles deviennent des antagonismes politiques.
Le salut par le commerce
Entre 1860 et 1914, environ 1,4 million de personnes ont fui l’Empire ottoman pour aller s’installer dans les Amériques. Si la majorité des migrants de cette première vague était d’origine syro-libanaise, la deuxième vague, qui démarre à partir des années 1920, compte de nombreux Palestiniens. La plupart sont chrétiens et originaires de Bethléem.Selon Yousef Al Jamal, universitaire et co-auteur de Palestinian Diaspora Communities in Latin America and Palestinian Statehood, l’Amérique latine abrite la plus grande diaspora palestinienne hors du monde arabe : environ 700 000 personnes, dont 100 000 au Salvador. À leur arrivée dans ce pays d’Amérique centrale pourtant, les choses ont plutôt mal débuté. Contrairement aux migrants européens, les Palestiniens n’ont pas eu le droit d’occuper des emplois agricoles. Pour tirer leur épingle du jeu, les nouveaux arrivants se sont alors tournés vers le commerce ambulant.Selon Cécilia Baeza, universitaire spécialiste des diasporas, les marchands palestiniens d’Amérique latine ont commencé à faire du porte-à-porte pour vendre des objets artisanaux religieux. De fil en aiguille, ils ont élargi leurs activités à d’autres produits manufacturés, jusqu’à ouvrir leurs propres magasins. Néanmoins, les élites salvadoriennes, d’origine européenne, ont considéré les Palestiniens – toujours qualifiés de « Turcos » en référence à l’Empire ottoman – comme des êtres issus d’une classe inférieure. Et comme ces élites détenaient le pouvoir, ce rejet mâtiné de xénophobie s’est traduit au niveau institutionnel et dans les textes de loi.