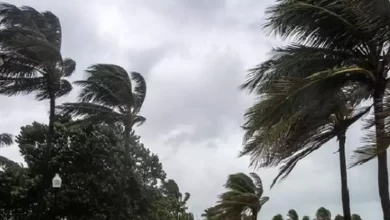JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME RURALE : Les bâtisseuses silencieuses d’une Algérie durable

Chaque 15 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de la femme rurale.En Algérie, cette date revêt une portée toute particulière, celle de rendre hommage à ces femmes qui, dans les campagnes, les montagnes ou les zones sahariennes, portent à bras-le-corps la vie, la terre et l’économie locale.
Un engagement gouvernemental structuré et cohérent
Invisibles mais indispensables, elles incarnent la force tranquille d’un pays en marche vers une économie plus verte, inclusive et durable. Sous le soleil des hauts plateaux ou à l’ombre des palmeraies du Sud, elles sont nombreuses à conjuguer les gestes ancestraux à la modernité. Productrices agricoles, artisanes, distillatrices d’huiles essentielles ou cheffes de micro-entreprises vertes, les femmes rurales sont aujourd’hui de véritables actrices de la transition écologique et économique. « Nos mères et nos grands-mères ont toujours vécu en harmonie avec la nature. Aujourd’hui, nous voulons faire de ce lien un moteur de développement », confie Raja Lahlahi, présidente de l’association Femmes Vertes de Kabylie. Son organisation accompagne une centaine de femmes dans des projets de recyclage artistique, de compostage et de valorisation des plantes médicinales. Pour elle, le défi est clair : « Donner les moyens aux femmes rurales d’exister économiquement, tout en protégeant leur environnement. »Cet engagement, le gouvernement algérien l’a inscrit au cœur de son programme d’action. Le secteur de l’Environnement et de la Qualité de la Vie, sous la direction de Madame la Ministre, accorde une place centrale à l’autonomisation des femmes et des jeunes dans les domaines de l’économie verte. Son département œuvre à la création d’entreprises vertes dirigées par des femmes dans plusieurs wilayas, en phase avec les orientations du Président de la République. Le Conservatoire national des formations à l’environnement joue ici un rôle clé. Il propose des formations spécialisées dans des domaines aussi variés que le compostage organique, la distillation d’huiles essentielles ou encore le recyclage artistique. Plus de 300 femmes ont déjà bénéficié de ces programmes, plusieurs d’entre elles ayant ensuite fondé des coopératives féminines participant à la revitalisation économique de leurs villages.
Des microcrédits pour des macro-impacts
Sur le terrain, les résultats sont tangibles. L’Agence nationale de promotion du microcrédit (ANGEM), placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, a financé près de 183 000 femmes rurales, dont 2 789 projets verts. Des chiffres qui traduisent une réelle dynamique d’intégration économique et de reconnaissance du rôle entrepreneurial des femmes rurales.À Tamanrasset, Khadidja Aït El Hadj, jeune entrepreneure, témoigne : « Grâce au microcrédit, j’ai pu lancer une petite unité de production d’huiles essentielles à base de plantes sahariennes. Aujourd’hui, je vends mes produits localement et en ligne. Ce projet a changé ma vie. » Ces initiatives, bien que modestes à leurs débuts, contribuent à créer une économie circulaire et à réduire la dépendance aux ressources classiques, tout en offrant des revenus stables aux familles rurales.
La solidarité comme pilier
Du côté du Ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, les efforts convergent. En effet, un travail permanent et régulier à l’autonomisation des femmes rurales à travers des programmes d’inclusion économique, de formation professionnelle et de soutien à la création d’entreprises. Des caravanes d’information sillonnent régulièrement les zones reculées pour sensibiliser les femmes aux dispositifs de soutien, les aider à s’inscrire sur les plateformes numériques et à monter leurs dossiers de microcrédit.Une collaboration interministérielle a également été mise en place avec le ministère des Start-up, pour renforcer les passerelles entre innovation, économie verte et entrepreneuriat féminin. Pour le sociologue Mohamed Djakoun, ces initiatives dépassent la simple question économique. « L’autonomisation des femmes rurales, c’est une révolution silencieuse. Lorsqu’une femme crée son activité, elle transforme non seulement sa vie, mais aussi celle de sa communauté. Elle change la perception du rôle féminin dans les villages et participe à la cohésion sociale. » Il insiste également sur le poids symbolique de la durabilité « Les femmes rurales incarnent l’équilibre entre nature et société. Elles savent que préserver la terre, c’est préserver la vie. »
Des startups féminines qui inspirent
Dans les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Laghouat ou El Oued, émergent de jeunes startups féminines portées par l’énergie du changement. Certaines développent des applications de suivi agricole durable, d’autres se spécialisent dans la fabrication d’emballages biodégradables ou le recyclage du plastique. « Notre objectif est de prouver que la ruralité n’est pas synonyme de retard, mais de résilience et d’innovation », affirme Hada Mahieddine Bali, fondatrice de la startup EcoRurale.